17/12/2012
La seule existence des pauvres remet en cause ce système social.

Par moments, les administrations publiques ont tendance à en finir avec ce problème de pauvreté en éliminant sa formulation. C’est pourquoi on fait souvent appel à la politique qui consiste à " nettoyer la ville " : on expulse les prostituées d’une zone, on renvoie les gitans d’un terrain, on démolit des maisons, on élargit une rue. Mais, dans tous ces cas, on ne s’occupe pas vraiment des personnes qui vivent dans un état de prostration sociale. Le problème se trouve posé quelques rues plus loin ou dans le quartier voisin. Et finalement, il subsiste.
La seule solution se doit donc d’être plus radicale : il faut que, dans toutes couches sociales, on lance le défi d’humaniser le système, de changer le style de notre monde occidental. Il se peut que dans certains cas nous réussissions à aider ces personnes qui sont dans la misère. Mais il se peut aussi que dans de nombreux autres cas nous nous heurtions à l’échec. Toutefois, ce qui est évident est que nous rendrons notre vie plus humaine en essayant d’humaniser la leur, et ce, que nous parvenions ou non à les faire sortir de la pauvreté.
Si, de l’intérieur de notre système, nous essayons de faire en sorte qu’ils ne soient plus en marge, nous échouerons peut-être ; mais nous ferons naître, probablement, un système ou un mode de vie qui ne sera pas générateur d’exclusion. Et c’est ce qui, à la longue, constitue la plus grande victoire. La personne installée dans le confort ne parviendra à devenir plus humaine que si elle accepte de sortir d’elle-même pour se rapprocher de l’autre, qui vit dans la misère. Et cet autre ne sera humanisé que dans la mesure où il pourra entrer en contact avec celui qui vit dans le confort. Ainsi, en faisant naître une relation à la place de ce qui était un mur, les deux parties du système deviennent plus humaines et avancent dans le même direction.
Toutes deux deviennent davantage des personnes. Alors que la révolution ne pouvait être faite que par les grands collectifs, l’humanisation apparaîtra à la portée de tout un chacun, et son efficacité sera d’autant plus grande que des gens se sentiront impliqués. Ceci ne veut pas dire que c’est une tâche facile à réaliser, mais c’est une tâche à la mesure de nos possibilités. Révolution et humanisation poursuivent exactement le même but : permettre à tous les hommes de vivre leur dignité humaine. Il y a pratiquement toujours eu des pauvres, d’une façon ou d’une autre. Cependant les caractéristiques des marginaux actuels, dans les grandes villes nanties, présentent des différences significatives par rapport à d’autres formes de pauvreté.
A première vue, on a l’impression qu’il est très difficile de résoudre le problème que pose cette nouvelle marginalisation, non pas tant à cause de sa dimension quantitative que par la complexité de sa réalité plurielle, et par les difficultés auxquelles nous nous heurtons quand nous voulons mettre un frein aux tendances à la reproduction de ce fait social. Les solutions trouvées par le passé pour lutter contre d’autres formes de pauvreté ne peuvent être réutilisées sans être adaptées. Mais, par ailleurs, il est vain de refuser de profiter de l’expérience d’altruisme de tant d’hommes qui nous ont précédés. Tirons donc des leçons du passé sans l’imiter. Les pauvres et marginaux sont les personnes qui n’ont pas suivi le progrès rapide du modernisme et se sont trouvées parquées sur le bas-côtés d’une autoroute où les voitures roulent tous les ans plus vite.
Et plus la rapidité du progrès, des changements techniques et culturels, est grande, plus grande est la difficulté du marginal à réintégrer le système social. La seule existence des pauvres remet en cause ce système social. En disant ceci, nous touchons l’un des points que les éducateurs qui travaillent auprès des marginaux soulignent le plus : la réalité de la marginalisation est symptomatique d’une maladie dont souffre tout notre système social. Et pour que ce constat entre réellement dans les mentalités, nous avons une dure bataille à livrer, car nous avons toujours tendance à penser que le problème des pauvres est celui des pauvres.
Nous disons volontiers : " ils n’ont pas eu de chance dans la vie ", alors qu’à la vérité c’est un problème de la société tout entière. Tout le corps est malade, mais les plaies n’apparaissent qu’à certains endroits. C’est pour cette raison, que le travail de terrain des éducateurs devient une tâche de plus en plus difficile et ardue. Et c’est aussi, pour cette raison que je me sens plus proche d’un éducateur tel que Guy Gilbert, qui vomit les technocrates du social qui se contentent de réfléchir sans jamais appliquer les valeurs humaines pour les porter au service des plus pauvres. Puis, les idéologues d’éventuelles révolutions sociales qui meurent avant de voir le jour car, elles ne sont que de purs concepts de l’esprit. C’est pour cette raison également que, jamais je ne fermerai ma gueule en tant qu’éducateur pour dénoncer les perversités de nos systèmes et y porter remèdes au quotidien, jusqu’au bout, sans jamais me lasser de vouloir humaniser notre société. Toujours, je témoignerai des carences que nos contextes socio-économiques génèrent et parlerai pour tous ceux et celles qui n’ont que le droit de se taire. Cela devrait être la vocation de tout acteur social et de tout être Humain.
Et des perpectives enrichissantes pour une nouvelle éducation Populaire vécue dans l’humus des dures réalités des pauvres, en travaillant avec eux et non sans eux, car la libération des opprimés sera l’oeuvre des pauvres conscientisés, dont les éducateurs seront les humbles accompagnateurs des mutations radicales qui se préparent en vue de leur dignité humaine.
Bruno LEROY.
19:21 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., LA PENSÉE DU JOUR., LA POÉSIE DE LA VIE, LA PRIÈRE DU JOUR., LE REGARD DE BRUNO., PÉDAGOGIE., PENSÉES PERSONNELLES, RÉFLEXIONS ET PENSÉES, THÉOLOGIE CONTEXTUELLE., VIVRE L'ÉVANGILE. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
01/01/2012
L’évangile du néo-libéralisme prêche la trinité du capital.

L’évangile du néo-libéralisme prêche la trinité du capital (dieu le père), du marché (le messie) et de la libre initiative (l’esprit). Elle annonce la réalisation d’une logique bienfaitrice pour tous, délégitimant et déclassifiant les opposants comme autant de démons à exorciser. Si l’on observe le langage néo-libéral, on y perçoit des termes religieux camouflés, particulièrement l’exigence d’un sacrifice pour un paradis futur.
A partir de sa compréhension de Dieu, la théologie de la libération réfléchit théologiquement sur l’économie, où prospèrent les idoles qui envahissent la politique et la culture . Elle démonte les « théologies » à l’œuvre dans nos systèmes économiques, pour les justifier et les légitimer. Il existe une « religion économique » dans le capitalisme, d’essence sacrificielle, sans transcendance. Cette religion falsifie les rêves et les désirs de la société traditionnelle, en lui annonçant le salut immanent dans l’abondance de biens de consommation. Le Dieu des pauvres, le Dieu de la vie, se transforme en une catégorie critique des faux dieux du système.
La chute du socialisme a permis « la messianisation du marché », la naturalisation des structures historiques du présent et la reprise du discours sur « la fin de l’histoire », de caractère théologico-eschatologique. L’évangile du néo-libéralisme prêche la trinité du capital (dieu le père), du marché (le messie) et de la libre initiative (l’esprit). Elle annonce la réalisation d’une logique bienfaitrice pour tous, délégitimant et déclassifiant les opposants comme autant de démons à exorciser. Si l’on observe le langage néo-libéral, on y perçoit des termes religieux camouflés, particulièrement l’exigence d’un sacrifice pour un paradis futur. Les riches accumulent davantage de biens, satisfaisant les désirs éveillés par une technologie fantastique qui provoque de nouveaux désirs. Les pauvres accentuent leur sacrifice, dans l’espoir illusoire de la satisfaction de leurs nécessités et de leurs rêves. C’est une spirale sans fin. La théologie de la libération démasque cette perversion, qui bénit les riches et punit les pauvres. C’est un dieu aux antipodes du Dieu de la vie, du Dieu des pauvres et de la tradition biblique et christique.
La mondialisation économique néo-libérale rencontre des critiques très vives de la part de la théologie de la libération, à cause de ses conséquences sur les pauvres : augmentation de la pauvreté, chômage, migration interne et externe de populations. En réponse, elle propose une mondialisation de la solidarité.
L’expérience concrète du Forum social mondial, qui a commencé à Porto Alegre en 2001, est devenue une source de réflexions et de commentaires utopiques. Toutes les grandes thématiques centrales retiennent l’attention : le principe du futur, la pensée plurielle, la résistance et l’alternative au modèle actuel de développement, le nouvel internationalisme, l’accès à la richesse et au développement durable, une autre démocratie par l’affirmation d’une société civile dans l’espace public, la démilitarisation d’un monde sans guerre, des stratégies pour affronter l’Empire, la réaction à l’homogénéisation de l’imaginaire par les médias internationaux…
Bruno LEROY.
20:35 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., LE REGARD DE BRUNO., MÉDITATIONS., MILITANTISME., THÉOLOGIE CONTEXTUELLE., THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
03/10/2011
Que faisons-nous pour les pauvres ?
Réflexion de l’archevêque de São Salvador da Bahia
ROME, Lundi 3 octobre 2011 (ZENIT.org) – « Nous arrivons à récupérer des navettes spatiales dans l’espace, à obtenir des progrès considérables dans la recherche sur le cancer et à développer des semences adaptées aux conditions climatiques de toute région, mais nous n’arrivons pas à ôter la faim avec ce qui tombe de nos tables, aux nouveaux Lazare qui nous tendent la main », souligne l’archevêque de São Salvador da Bahia (Brésil), Mgr Murilo S.R. Krieger. Il souligne dans un article l’incapacité de la société moderne à réduire la pauvreté malgré tous ses progrès.
« Je n’aide pas qui fait l’aumône » ; « Voilà le résultat d'une société basée sur l’injustice » ; « Où passe l’argent de nos impôts ? » ; « Pourquoi le gouvernement ne fait rien pour ces personnes ? » ; « Mon Dieu, quel visage souffrant ! »; « Que puis-je faire ? » : Voici quelques unes des réactions auxquelles on assiste quand quelqu’un demande de l’aide pour vivre, relève-t-il.
« Il y a eu des époques dominées par les œuvres d’assistance. Il s'agissait de 'donner du poisson' aux plus nécessiteux parce que la faim exigeait des actions rapides » explique le prélat. « Ensuite sont nées les initiatives visant à la promotion humaine ; l'important disait-on est d'enseigner à pêcher, pour éviter la dépendance permanente ».
Aujourd’hui, explique-t-il, sont nés de nouveaux besoins et il y a beaucoup de pauvres dans tous les secteurs (économique, social), au plan physique ou moral. « Les structures de notre société doivent changer du tout au tout pour que cesse le processus d’appauvrissement » .
Dans ce contexte Mgr Krieger souligne l’importance de participer à des initiatives comme celles « en faveur des enfants pauvres, des femmes enceintes abandonnées par leurs maris, des adolescents motifs de préoccupation ou des personnes âgées sans famille et sans amour ».
« S’intéresser à ces initiatives ou s’offrir comme volontaire pourra être le premier pas dans la découverte de nouvelles réponses aux problèmes sociaux qui se présentent à nous comme des défis », commente-t-il.
« Nous découvrirons alors que nous sommes riches d’espérance car quelqu’un, un jour, nous a tendu la main et nous a relevé, nous donnant une dignité et des raisons de vivre ».
22:28 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans LES BLOGS AMIS., THÉOLOGIE CONTEXTUELLE., VIVRE L'ÉVANGILE. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
29/03/2011
Plus de justice et de participation.
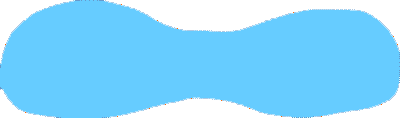
Les chrétiens se voient confrontés au péché social et structurel de l’oppression et de l’injustice infligées aux masses. Il s’agit du péché qui de situe dans les institutions et les structures de la société, et qui conduit les personnes et les groupes à avoir des comportements en contradiction avec le projet de Dieu. Précisons ici que les structures ne sont pas des choses mais des modes de relation entre les choses et les personnes qui ont affaire à elles.
Vouloir surmonter le péché social suppose que l’on s’attache à changer les structures afin qu’elles produisent en fonctionnant plus de justice et de participation. La conversion évangélique réclame plus qu’un changement de cœur ; elle exige aussi un changement de l’organisation sociale qui provoque indéfiniment des comportements de péché.
Cette conversion sociale se traduit par une lutte sociale transformatrice, et elle s’appuie sur des stratégies et des tactiques susceptibles d’ouvrir la voie aux modifications nécessaires. Au péché social il faut opposer la grâce sociale, fruit du don de Dieu et de l’activité de l’homme inspiré par Dieu.
La charité comme mode d’être-aux-autres gardera toujours toute sa valeur. Mais, dans une perspective sociale, aimer signifie participer à la création de nouvelles structures, soutenir celles qui représentent une avancée pour obtenir une meilleure qualité de vie, et bien se situer dans le domaine politique à la lumière de l’option solidaire pour les pauvres. Jésus a donné l’exemple : il peut y avoir compatibilité entre l’Amour pour les personnes et l’opposition à leurs attitudes.
Il s’agit d’aimer toujours les personnes et dans n’importe quelle condition, mais de combattre les attitudes et les systèmes qui ne s’accordent pas avec les critères éthiques du message de Jésus. La paix et la réconciliation sociales ne seront possibles que dans la mesure où auront été surmontés les motifs réels qui distillent en permanence les conflits : les relations inégales et injustes entre le capital et le travail, les discriminations entre les races, les cultures et les sexes.
Ainsi, aimer sans haïr, lutter pour le triomphe de la juste cause sans céder au leurre des émotions, tout en respectant la diversité des opinions, en relativisant ses propres positions et en sauvegardant l’unité de la communauté, tels sont les défis concrets qui sont proposés à la sainteté des chrétiens libérateurs.
Bruno LEROY, éducateur de rue.
22:30 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., LE REGARD DE BRUNO., POUR LES JEUNES., PSYCHOLOGIE., SPIRITUALITÉ, THÉOLOGIE CONTEXTUELLE. | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
18/02/2011
Espérer, ce n'est pas ignorer la mort, mais l'affronter pour Vivre.
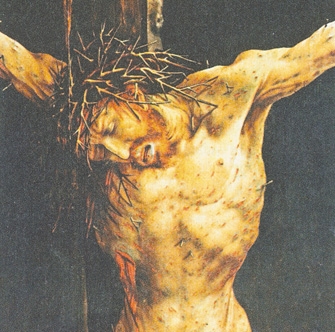
17:29 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., COMBAT SPIRITUEL., CONSEILS SPIRITUELS., LA POÉSIE DE LA VIE, LE REGARD DE BRUNO., THÉOLOGIE CONTEXTUELLE. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
15/02/2011
Quel est le type de poésie qui nous fera redécouvrir le mystère du monde ?

Il existe un lien incontournable entre la qualité de relation que l’on entretient avec soi-même et celle que nous souhaitons établir avec l’Autre. Il n’est pas de relation à l’autre si un minimum vital d’amour pour soi n’est pas assuré.
La spiritualité serait en chacun ce minimum de cohérence et d’amour avec et pour soi-même qui fait qu’un être humain se tient dans son identité. Une sorte de sérénité ou de sécurité fondamentale, d’acquiescement à sa propre singularité, ce par quoi chacun est incommunicable et qui permet pourtant qu’il entre en relation. Du coup, le spirituel serait aussi ce qui en l’homme passe l’homme, l’ouvre à l’Universel, lui permet de prendre du recul, de ne pas s’engluer toujours dans le particulier, de percevoir les enjeux au-delà de l’immédiat, d’inventer avec d’autres, une histoire.
Cette dimension spirituelle appartient à tout homme et ne relève pas d’abord du " religieux ". Le spirituel, entendu en ce sens, n’est pas désincarné. " Car le spirituel est lui-même charnel ", nous rappelait Péguy. Comment en serait-il autrement s’il signifie l’adhésion d’un être avec lui-même, en même temps que son ouverture aux autres, tel qu’il est, tels qu’ils sont.
Nous entrons dans une écologie mentale, l’écologie de l’esprit qui permet de revaloriser le noyau émotionnel et porteur des valeurs de l’être humain, face à la nature. Elle permet de développer l’aptitude à l’intimité, d’être à l’écoute du message que tous les êtres diffusent par le simple fait qu’ils sont là, par leur relation à ce qui les environne, par leur capacité de symbiose avec l’univers pris dans sa complexité, dans sa majesté et dans sa grandeur. Elle conduit au renforcement des énergies psychiques positives de l’être humain pour pouvoir affronter avec succès le poids de l’existence et les contradictions de notre culture dualiste, machiste et consommatrice.
Sans révolution de l’esprit, une révolution de la relation entre l’individu et la nature sera impossible. L’écologie mentale trouve ses racines dans la profondeur humaine. C’est là que s’élaborent les grandes motivations, la magie secrète qui transforme le regard sur la réalité, la transfigurant en ce qu’elle est, un maillon de l’immense communauté cosmique.
Si, l’éthique dégénère en codes de préceptes et d’habitudes de comportement, l’écologie mentale court le risque de se perdre dans la fascinante symbolique intérieure, si toutes deux ne sont pas l’expression d’une spiritualité ou d’une mystique. Quand nous parlons de mystique, nous pensons à une expérience fondamentale englobant toute chose, par laquelle la totalité des choses est captée en tant qu’ensemble organique chargé de signification et de valeur. Quel est le type de poésie qui nous fera redécouvrir le mystère du monde et notre sensibilité, afin que tous les êtres puissent être reliés ?
Quelle puissance spirituelle vécue nous engendrera dans cette société dont nous sommes tous frères. Nul n’est étranger sur n’importe quel morceau de terre. Et surtout pas les Roms, ces fils de liberté, les Arabes, ces fils de Lumière, Les Noirs, ces fils de sang battant, les Chinois, ces fils de sagesse et tous les étranges étrangers qui forment les couleurs de notre planète. Tout individu est un frère, un soleil qui éclaire nos valeurs manquantes. Un spirituel Apôtre du Christ se doit, plus que tout autre, retisser du lien social. Il vit l’utopie du Royaume de Dieu sur Terre. Et peu importe qu’il soit ridiculisé, exclu à son tour du regard des bien-pensants.
La prière donne l’oxygène nécessaire aux personnes strangulées par les autres.
Son devoir est de plaire à Dieu plutôt qu’aux Hommes et ceci même si son comportement fraternel et généreux, contredit cette société orgueilleusement égoïste. Nous avons Tous le même Père donc nous sommes tous frères en Humanité. Et cette Vérité évangélique, voire métaphysique ne saurait être contredite, ni souffrir d’exceptions.
Bruno LEROY.
19:36 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., LA POÉSIE DE LA VIE, LE REGARD DE BRUNO., SOCIOLOGIE., SOLIDARITÉ., SPIRITUALITÉ, THÉOLOGIE CONTEXTUELLE. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
23/01/2011
L'Amour est épanouissement constant de la Vie.
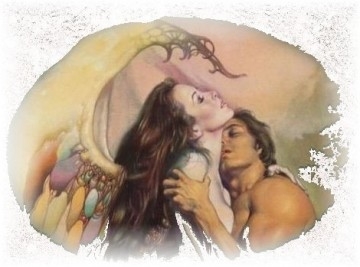
12:21 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., CONVERSIONS, LA POÉSIE DE LA VIE, LE REGARD DE BRUNO., MÉDITATIONS., PÉDAGOGIE., PENSÉES PERSONNELLES, POUR LES JEUNES., RÉFLEXIONS ET PENSÉES, RÉFLEXIONS LITTÉRAIRES., RÉFLEXIONS., SOCIÉTÉ., SPIRITUALITÉ, THÉOLOGIE CONTEXTUELLE., VIVRE L'ÉVANGILE. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
18/01/2011
Intervention Mgr. SCHERRER, Evêque de Laval.
« L’hospitalité à l’épreuve du temps » : c’est le titre de la contribution que donnera Sœur Sophie de Saint Joseph, Petite Sœur des Pauvres, mais c’est plus largement le thème inspirateur de ce congrès qui rassemble les Présidents et Présidentes des Hospitalités ce weekend. Puisqu’il m’a été demandé d’introduire cet évènement, c’est bien volontiers que je prends la parole ce matin. Je laisserai le soin à sœur Sophie d’approfondir le sens de l’hospitalité dans la lumière donnée par le témoignage de Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Pour ma part, j’aimerais davantage valoriser le sens et l’importance du temps, ce temps, dont la dimension, avec celle de l’espace, fait partie intégrante de notre condition de créatures. Impossible de penser notre destinée d’hommes et de femmes créés par Dieu en dehors de cette dimension du temps. Chrétiens, notre vocation est d’aimer à la manière de Jésus, mais nous voyons bien que cet appel fondamental ne se vit pas simplement dans la ferveur des commencements, mais qu’il se déploie dans la durée du temps, dans la dynamique d’une maturation et d’une croissance qui est constitutive de cet appel plus fondamental encore à être et à devenir des saints et des saintes selon l’invitation de Pierre dans sa première épître : « À l’exemple du Saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, parce que moi, je suis saint » (1 Pi 1,15-16).
C’est le grand défi, en particulier quand nous préparons des fiancés au mariage, de les faire entrer dans cette compréhension du temps si décisive pour mener à bien cette aventure de la vie conjugale et la rendre féconde dans tous les sens du terme. La question de la durée dans le temps est aujourd’hui une question essentielle. Car nous vivons dans une civilisation de l’immédiateté, du tout, tout de suite. Nous le constatons dans les exigences commerciales de nos contemporains. Si j’ai envie d’un réfrigérateur, d’une auto ou d’un ordinateur, aucun obstacle ne doit m’empêcher de l’acquérir dans les délais les plus brefs. Il en va de même sur le plan des relations amoureuses elles-mêmes ; on le voit bien aujourd’hui, ce qui prévaut bien souvent, c’est le nomadisme sentimental et affectif. On imagine trouver son épanouissement dans des expériences fugaces, éphémères, changeantes. La durée du temps est pourtant la seule vérification de notre amour. « La fidélité dans le temps est le nom de l’amour » (Benoît XVI à Fatima). Avant lui, Jean-Paul II avait parlé d’une « loi de gradualité » pour évoquer cette tension progressive des époux vers cet idéal de l’amour humain transfiguré par l’amour de Dieu (1).
Toute vocation, quelle qu’elle soit, intègre cette dimension essentielle du temps. Or nous mesurons tous notre incapacité, sans la grâce de Dieu, à inscrire nos ‘oui’ dans cette progressivité ascendante, dans cette gradualité dont parlait Jean-Paul II ; nous voyons bien qu’il nous est difficile de faire nôtre cette exigence de gratuité qui consiste à durer dans l’amour, qui consiste à grandir dans ce que j’appellerais la « constance » de l’amour. Le grand défi de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, c’est d’entrer jour après jour dans la constance de l’amour ; c’est d’apprendre à ne plus zapper avec nos sentiments, avec nos émotions, avec nos promesses, nos résolutions pour entrer avec celui qu’on a choisi d’aimer dans la vérité d’une relation qui dure.
C’est peut être ici l’occasion de nous redire ce qui fait l’originalité du christianisme dans sa manière singulière de comprendre et de concevoir le temps. Le christianisme a apporté un sens de l’histoire. C’est le premier rappel que je voudrais faire en commençant.
I. LA CONCEPTION DU TEMPS DANS L’HELLÉNISME ET LE JUDÉO-CHRISTIANISME
Chez les Grecs, d’abord – mais c’est déjà vrai dans les cultures les plus anciennes et les plus traditionnelles (l’hindouisme : les Veda, datés de 1500 avant notre ère) –, le temps se déroule selon un cycle éternel où toutes choses se reproduisent indéfiniment. C’est le mythe de l’éternel retour qui induit chez l’homme de culture grecque une soumission au temps qui sera nécessairement ressentie comme un asservissement et une malédiction. « De là vient que la pensée philosophique grecque s’épuise à résoudre le problème du temps. De là également tous les efforts qu’elle fait pour se libérer, pour échapper à ce cycle éternel, c’est-à-dire pour s’affranchir du temps lui-même. Les Grecs ne peuvent concevoir que la délivrance puisse résulter d’un acte divin accompli dans l’histoire temporelle. La délivrance réside, pour eux, dans le fait que nous passons de notre existence d’ici-bas, liée au cycle du temps, dans l’au-delà, soustrait au temps et toujours accessible. La représentation grecque de la félicité est donc spatiale, définie par l’opposition entre ici-bas et au-delà ; elle n’est pas temporelle, définie par l’opposition entre le présent et l’avenir. Elle ne saurait être déterminée par le temps, puisque celui-ci est conçu comme un cercle » (2).
En sens contraire, dans la prédication chrétienne primitive, la conception du salut est rigoureusement temporelle. Pour les chrétiens, le temps n’est pas un cercle, mais une ligne droite, une ligne ascendante à laquelle on attribue un commencement (archè) et une fin (telos). Au centre de cette ligne se situe l’évènement de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth, ce Jésus, Christ, que nous reconnaissons, nous chrétiens, comme la révélation absolue (et définitive) de Dieu aux hommes. C’est à partir de ce point central que s’opère le décompte des années dans notre système chronologique, une habitude qui a été prise définitivement au XVIII° siècle.
Parce que le temps en christianisme est conçu comme une ligne ascendante, un « accomplissement » (plerôma) y devient possible. Compris de cette manière, le temps n’est pas une réalité opposée à Dieu, mais le moyen dont Dieu se sert pour révéler l’action de sa grâce... et j’ajouterais, le moyen pour nous, les hommes, de sceller notre destinée personnelle et collective par des choix de liberté qui soient vraiment salutaires, porteurs d’amour. On perçoit donc cette particularité essentielle du christianisme : si les anciens subissaient le temps, les chrétiens, eux, le vivent à plein comme une réalité donnée par le Créateur. C’est l’expérience que fait chaque individu : il vit un temps fini qu’il ne se donne pas mais qu’il reçoit. Le temps des chrétiens est un temps donné : notre existence elle-même est un don, c’est une chance qui nous est accordée. Elle est le lieu où notre liberté est appelée à s’épanouir et à se déployer dans le sens du don. Créés libres à son image et à sa ressemblance, nous sommes « appelés par Dieu à vivre la durée située entre notre naissance et notre mort dans l'amour de Dieu et l'amour des autres, durée parcourue comme un chemin vers le Royaume, voie ouverte par le Christ lui-même et définie par lui » (3). C’est ainsi que le temps chrétien est par excellence le temps de l’espérance, un temps ouvert à la fois à la corporéité et à l’intersubjectivité :
- à la corporéité, en ce sens que notre corps, par lequel nous sommes en ouverture sur le monde, est le lieu où nous prenons conscience de notre finitude et en même temps de la valeur du temps qui nous est accordé. Pour cette raison, la maturité du temps ne vient pas de sa durée biologique mais du drame qui s’y joue. On pense à tous ces saints (Stanislas Kostka, Louis de Gonzague, Thérèse de Lisieux, etc.) ou ces génies (Mozart, Schubert) qui sont morts jeunes et ont saisi l’instant de la chance dans le temps qui leur était accordé ; ils sont su, par leur sainteté et leur génie justement, inscrire dans la brièveté des jours une sorte de plénitude, d’absolu. Ils ont inscrit l’absolu dans le fragmentaire (4).
- à l’intersubjectivité, car l’ouverture du temps propre ne se fait pas seulement en direction du monde, il se fait aussi en direction de l’autre. L’homme est un être social, un être de relations, un être, par conséquent, dont les actes librement posés ont une incidence collective. Mystérieusement, les choix que nous posons, les décisions personnelles que nous prenons dans le déploiement de ce temps qui nous est propre, ces décisions, aussi petites soient-elles, affectent la destinée de l’humanité en général. C’est ainsi que le temps personnel et le temps collectif se croisent, s’interpénètrent. Autant le dire, notre existence est unique, et parce qu’elle est unique, elle s’offre comme un « chantier » où chacun est invité à construire son éternité, mais avec cette conviction qu’on ne peut opérer son salut qu’en coopérant au salut de tous. Comme le disait Denise Legrix : « Le véritable bonheur est de faire celui des autres ». De là l’importance de remplir chaque instant d’une plénitude de sens et d’une plénitude d’amour en se donnant aux autres, tout spécialement les pauvres et les malades, dans une attitude de service et d’hospitalité.
II. CRÉATION INITIALE ET CRÉATION CONTINUÉE
En christianisme, nous sommes donc dans la conception d’une ligne temporelle de l’histoire du salut qui va de la création initiale à la nouvelle création, celle que le Christ a inaugurée par sa mort et sa résurrection. Saint Irénée de Lyon est l’un de ceux qui ont su le mieux mettre en valeur cette dynamique d’un salut de l’homme par Dieu qui intègre la dimension du temps. Irénée qui est un grand connaisseur des Saintes Écritures sait que le monde de la Genèse est créé une fois pour toutes par l'unique Dieu Créateur dans un acte d'amour. Mais il montre comment cette création ne s’est pas opérée d’un seul coup, comme par un simple maniement de baguette magique : la création de Dieu est échelonnée dans le temps, par étapes successives. Comme l'artiste crée son œuvre, Dieu procède par degrés, par phases, par touches successives. L’opération de Dieu, son action créatrice est en réalité coextensive à toute l’histoire de l’humanité, du début jusqu’à la fin. C’est pourquoi Irénée insiste très fort sur le fait que Dieu ne créé pas l’homme parfait dès le commencement, mais perfectible, afin de se donner la joie de pouvoir le combler selon une dynamique de croissance (incrementum) et de progrès (augmentum) correspondant à la fois aux capacités forcément limitées de la créature et à la surabondance d’Amour du Créateur. Pour le dire autrement, la raison de la création temporelle est dans l’ajustement graduel de la créature aux biens toujours plus nombreux que Dieu entend lui prodiguer. C’est par conséquent toute l’histoire qui, dans son déroulement, dans son déploiement, est pensé comme le lieu d’une divinisation progressive de l’homme. Cela est manifeste dans la théologie d’Irénée pour qui la loi du temps a une fonction révélatrice et épiphanique de l’Amour de Dieu et de sa puissance. Dieu, écrit Irénée, est « Celui-là même qui a toujours davantage à distribuer à ses familiers, et qui à mesure que progresse leur amour pour Lui, leur accorde des biens toujours plus nombreux et plus grands » (5).
L’originalité de la doctrine juive et chrétienne de la création est là : dans cette affirmation de l’immanence de l’action créatrice de Dieu en tout être, une action ininterrompue depuis les origines. Dans cet esprit, l’homme créé à l’image et à la ressemblance du Créateur est appelé à passer sans cesse d’un moins-être à un plus-être. Saint Paul dira : de « psychique », il doit devenir « spirituel » (cf. 1 Co 15,45). L’apôtre est celui qui nous explique le mieux comment nous avons été créés dans le Fils, ou plus exactement comment nous avons été créés vers le Fils, ce qui signifie que notre perfection est liée à l’image divine pleinement manifestée à la fin des temps dans l’humanité glorifiée du Fils de Dieu. La vocation de l’homme, dira Paul, c’est de parvenir à « la plénitude de la stature du Christ » (cf. Eph 4,13). Il y a, sous-jacente à la pensée chrétienne, comme une loi d'entropie positive du genre humain en marche vers son accomplissement ultime. C’est pourquoi la perfection de la créature n’est pas située au début, mais à la fin : la création achevée, l’humanité parfaite, nous la contemplons déjà dans la personne du Christ ressuscité, dans son humanité glorifiée. C’est vers cette ressemblance avec le Christ que nous devons tendre avec toutes les forces de notre foi, de notre espérance et de notre amour.
a) L’espérance chrétienne et les dimensions du temps
Il y a donc une tension eschatologique de l’homme en chemin vers la plénitude de son accomplissement, et c’est cette tension eschatologique qui fonde la singularité de l’espérance chrétienne. Il est intéressant de voir comment l’espérance chrétienne intègre les trois dimensions du temps :
- le passé, avec la mort-résurrection du Christ comme évènement situé dans l’histoire
- le présent avec l’action présente du Christ ressuscité à l’œuvre dans notre monde
- le futur avec l’attente de l’avènement du Royaume plénier de Dieu
Voilà les trois assises sur lesquelles repose l’espérance chrétienne. On comprend à partir de là que le Royaume de Dieu qui est objet de notre espérance n’est pas simplement et purement une réalité de l’au-delà. Ce Royaume, qui a été inauguré dans l’activité de Jésus (sa prédication, l’accueil et le pardon qu’il a réservé aux pécheurs, les miracles qu’il a accomplis), continue de s’édifier en chacune de nos vies, à travers nos engagements, nos combats, nos souffrances aussi. On perçoit peut-être mieux, à partir de là, ce qui confère à l’espérance chrétienne sa physionomie propre. Beaucoup en effet voient dans l’espérance une sorte d’utopie qui nous propulserait dans un au-delà de nous-mêmes jusqu’à nous faire démissionner de nos tâches présentes. On se souvient que les athéismes et les philosophies du soupçon voyaient dans l’espérance chrétienne un « opium » pour le peuple, comme un moyen de s’évader dans des paradis artificiels pour échapper à cette condition humaine parfois douloureuse et pesante qui est la nôtre. Mais rien n’est en réalité plus étranger à nos convictions nourries de l’Évangile. L’espérance n’est pas une fuite en dehors de notre histoire. Elle nous amène à construire l’avenir dans le hic et nunc de nos existences et de nos engagements. Par conséquent, loin d’être une démission, l’espérance est au contraire au fondement même de la mission et de l’engagement chrétien. L’espérance qui est tendue vers le futur se vit au présent. Elle est « une force qui nous tire audacieusement vers l’avant, vers la nouveauté, vers le changement, l’inédit. Elle est le contraire de la nostalgie du passé et de la stagnation, de l’immobilisme » (Bruno Leroy). Elle est la « petite sœur, disait Péguy, qui fait marcher les deux autres (la foi et la charité) ». C’est donc une vertu qui nous engage au plus haut point, qui nous presse à aimer nos semblables, à leur offrir le témoignage d’une vie où la parole est en cohérence avec les actes. Espérer, c’est s’engager personnellement pour que le monde devienne plus lumineux et un peu plus humain. L’espérance est donc créatrice ; elle nous rend acteurs de la transfiguration du monde et de l’histoire. C’est l’expérience des saints et des saintes.
Espérer, c’est en définitive faire entrer notre vie dans le réel de nous-mêmes sachant que pour un chrétien, notre réel, notre vraie substance, c’est le Christ en personne qui, par sa mort et sa résurrection, nous a déjà fait « passer » (c’est le sens du mot Pâques) de ce monde dans le monde nouveau. Comme chrétiens, nous croyons que l’humanité a de l’avenir parce que, précisément, Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Un vrai chrétien est donc quelqu’un qui vit comme il espère. Le grand drame de beaucoup de nos contemporains, c’est qu’ils passent toute leur vie à côté d’eux-mêmes, ils laissent leur existence se dissoudre dans le néant, le hasard, l’éphémère, l’accidentel. En sens contraire, Benoît XVI, dans son beau discours aux Bernardins, a mis en valeur l’exemple des moines qui ont vécu le temps comme une entrée dans l’éternité : « Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante : s’appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la Vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui, seul, est vraiment important et sûr. On dit que leur être était tendu vers l’eschatologie ».
b) Vivre la grâce de l’instant présent
Impossible par conséquent de comprendre le salut chrétien sans cette tension eschatologique de l’homme vers Dieu. Cette édification du Royaume nouveau intègre l’efficacité des sacrements. Par les sacrements, en effet, le monde invisible est déjà présent réellement : « cela est », ainsi que le prêtre le dit lors de la consécration du pain eucharistique.
Les sacrements vécus dans le temps nous font déjà sortir de ce temps qui s’écoule pour nous rendre présent à l’éternel Présent. Ils nous font prendre la dimension de notre être éternel.
C’est ainsi que la liturgie célèbre l’irruption de l’éternité dans le temps. De Noël à Pâques, de l’Ascension à la Pentecôte, au gré des rendez-vous successifs du calendrier liturgique, nous entrons dans l’aujourd’hui de la création nouvelle inaugurée par la résurrection du Christ.
Voilà pourquoi le véritable appel qui nous est adressé comme chrétiens, c’est de vivre l’aujourd’hui de Dieu et de son amour, c’est de vivre l’instant présent de sa grâce. La manière dont nous vivons l’instant présent est la vérification concrète de notre attachement au Christ et à son Église. C’est en vivant intensément l’instant présent que nous progressons vers le Royaume et le faisons déjà advenir en ce monde. Un proverbe espagnol dit en sens contraire :
« Le chemin de tout à l’heure et la route de demain mènent au château du rien du tout ».
L’instant présent est chemin vers la sainteté parce qu’il est le point de contact avec la volonté divine. Nous n’atteignons Dieu que dans chaque instant : vivre chaque instant avec un maximum d’amour, voilà le secret d’une vie chrétienne heureuse.
C’est bien là certainement un grand défi à relever quand on voit aujourd’hui à quel point notre rapport au temps a changé. Nous sommes témoins en effet d’une formidable accélération du temps ces trente ou quarante dernières années :
- par les progrès de la technologie : nos manières de communiquer, de nous déplacer ont considérablement changé les modes de vie.
- la société de consommation nous place devant une multiplicité de choix matériels et relationnels (produits d’alimentation, sports, loisirs)
- l’afflux massif d’informations qui nous viennent de toutes parts engendre un phénomène d’extériorisation maximale qui fait que le temps externe a pris la majeure part de notre perception au détriment de notre temps interne, de ce qui se passe à l’intérieur de nous (question du déficit d’intériorité chez les jeunes générations).
Le temps numérique, celui de nos montres, a fini par imposer sa dictature au cœur de nos vies, sans que nous ayons pu résister à sa conquête. Ce temps numérique qui règle nos journées est aussi une mesure de l’efficacité économique. Combien de machines ont remplacé les hommes pour des raisons de temps. Et c’est même devenu un critère dans le recrutement et le management des hommes entre eux : dans les embauches, on privilégie ceux qui font en deux heures ce que d’autres font en quatre. On en est arrivé à cette déformation qui nous fait concevoir l’accélération comme une qualité : aller plus vite, c’est être plus intelligent, aller plus vite, c’est être plus heureux. Mais en réalité, depuis 15 ou 20 ans, je parle pour notre monde occidental, nous constatons une régression de l’humanité. On a vu régresser notre comportement humain dans sa capacité relationnelle, dans sa capacité à être heureux, sa capacité à se suffire de ce que l’on a. « Tout doucement est en train de s’installer en nous la perception de l’échec du temps linéaire. C’est là une révolution culturelle majeure : s’apercevoir que demain n’est pas toujours mieux qu’hier, que cette grande hypothèse du XVII° siècle qu’on va toujours vers mieux est en train d’être vouée à l’échec » (6).
Comment, à partir de là, ré ancrer le temps dans la personne ? En retrouvant cette dimension fondamentale de la rythmique corporelle. Le fait est qu’il faudra toujours neuf mois pour faire un enfant, qu’on n’est pas plus intelligent à 10 ou 20 ans aujourd’hui qu’il y a dix mille ans, signe que la rythmique de l’éveil de l’intelligence ne s’accélère pas. Il y a donc un temps naturel, un temps fondamental. C’est à ce temps de la nature qu’il faut savoir par moments se ré étalonner, ce que favorise par exemple l’occasion des vacances chaque été en famille, ce qu’on redécouvre également à travers les pèlerinages (en particulier celui de Saint Jacques de Compostelle) qui suscitent un engouement croissant depuis plusieurs années.
La deuxième manière de ré ancrer le temps dans la personne, c’est de redécouvrir comment la valeur du temps est liée concrètement à ce que nous vivons. Et ça, c’est la relation humaine.
« La relation humaine est le lieu où je découvre avec émerveillement que l’essentiel, c’est de perdre du temps ; pas simplement d’en prendre, mais d’en perdre. On ne commence vraiment à aimer que quand on perd du temps»7. Mère Teresa disait : « Ne laisse jamais quelqu’un que tu rencontres avant qu’il ne soit heureux de ta rencontre ».
N’est-ce pas le grand défi à relever lorsqu’on s’engage à accompagner les malades !
C’est cet amour au présent en effet qu’attend le pauvre, le malade, notre prochain. Cet amour exige une attention particulière : une attention qui passe par le regard : regarder autrui, c’est s’efforcer de percevoir ses besoins, ses désirs, ses difficultés, ses aspirations, ses souffrances. Et c’est, après les avoir pressentis et découverts, lui donner ce qu’il attend et ce qui lui manque. Cet amour suppose que l’on se mette sur le même plan que l’autre, sans ombre de mépris, de condescendance : ne pas jouer au docteur si on ne l’est pas, ni au psychologue. Il faut avoir sur l’autre un regard d’amour, un jugement d’amour. Evidemment, cette disponibilité à l’autre ne va pas sans une permanente désappropriation de soi. C’est en ce sens que le temps constitue une mise à l’épreuve de notre charité, de notre agir chrétien. Pouvoir l’intégrer concrètement dans nos engagements caritatifs ou pastoraux est en définitive le moyen le plus sûr d’entrer dans le véritable esprit de l’hospitalité chrétienne. Je vous remercie de votre attention
_____________________________________
1 . Cf. Exhortation apostolique Familiaris Consortio, n. 34.
2 . Oscar CULMANN, Christ et le temps, Delachaux et Niestlé 1965, p. 37.
3 . Solange THIERRY, « Temps de l’Inde et temps chrétien ». Sur le site www.religions.free.fr. L’auteur est ancienne directrice d'études à l'École Pratique des Hautes Études de la Sorbonne et spécialiste de la culture orientale et du sanskrit.
4 . Mais on peut tout autant parler de ceux dont la vocation s’est opérée sur le tard, comme Sainte Thérèse d’Avila, Jeanne Jugan, Petite Soeur Magdeleine, Mère Teresa, des fondatrices d’ordre qui avaient toutes autour de la quarantaine au moment où leur choix de vie s’est précisé. Elles ont « rattrapé »le temps avec une audace et une foi extraordinaires.
5 . Adversus Haereses IV, 9,2.
6 . Samuel ROUVILLOIS, « La gestion du temps », Dossier paru dans Vivre Marie, Bulletin de l’Amicale des Petits
Frères de Marie, n° 139, septembre 2010, p. 18.
7 . Ibid., p. 19.
Lire sur le lien suivant : http://www.asprehofran.net/rubrique,intervention-mgr-sche...
20:16 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans LES BLOGS AMIS., SPIRITUALITÉ, TÉMOINS DE CE TEMPS., THÉOLOGIE CONTEXTUELLE., THÉOLOGIE., VIVRE L'ÉVANGILE. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
28/06/2008
Quelle espérance dans le monde actuel ?

« Seigneur, au nom de mon frère le voleur, je demande pardon. Il ne savait pas ce qu’il faisait, Il ne savait pas que tu es vraiment vivant et présent dans l’eucharistie. Ce qu’il a fait nous touche profondément. Mais mes amis, mes frères, comme nous sommes tous aveugles ! Nous sommes choqués par ce que notre frère, ce pauvre voleur, a jeté les hosties, le Christ eucharistique dans la boue. Mais dans la boue vit le Christ tous les jours chez nous, au Nordeste. Il nous faut ouvrir les yeux ».
Il s’agit de découvrir le visage de Jésus-Christ à travers celui des pauvres. Il s’agit aussi de se rappeler que le Rédempteur nous veut co-rédempteurs. A nous de combattre avec lui contre les conséquences du péché, en nous-mêmes et dans le monde. Non par idéologie, mais par amour.
Cette théologie de la libération s’est développée dans les pays d’Amérique latine, puis en Afrique du Sud, aux Philippines et en Corée du Sud ainsi qu’en d’autres lieux frappés par la misère et la dictature. Elle est le fruit de théologiens qui, à partir des années 1970, se veulent solidaires des plus pauvres. Ces théologiens visent à expliciter la foi des communautés chrétiennes qui vivent l’oppression et la misère, mais qui sont portées par l’espérance évangélique. Partant de la conviction que la pauvreté extrême n’est pas une fatalité mais la conséquence de structures sociales et économiques injustes, ces théologiens – catholiques et protestants – font appel aux sciences sociales pour déceler les mécanismes sociaux qui produisent la pauvreté.
Les théologiens de la libération dénoncent non seulement les structures sociales et économiques injustes, mais aussi, et très concrètement, les pouvoirs en place et l’égoïsme de minorités puissantes qui condamnent la majorité des habitants des pays du Sud à des conditions de vie infrahumaines. Le monde actuel n’est donc pas plus civilisé, disent-ils, que quand les hommes réglaient leurs différends à coups de poings et de gourdins. Il est, au contraire, plus dangereux et plus cruel. La capitalisme, particulièrement sauvage dans les pays du Sud, en est la cause. Ils estiment que les masses du « tiers-monde » ont à recouvrer la dignité humaine que le Créateur leur a donnée.
Nécessité d’une transformation structurelle
Le thème central de cette théologie est la libération en tant que manifestation de la volonté de Dieu envers les opprimés et en tant qu’exigence pour le chrétien. On entend par le terme de libération tout ce qui vise à desserrer l’étau de l’exploitation économique et de la domination politique qui entrave leur liberté. Cette théologie implique la dénonciation des injustices ainsi que la transformation structurelle des sociétés où règne l’oppression. Elle se voit puissamment encouragée par la déclaration faite par l’ensemble des évêques catholiques d’Amérique latine réunis en 1968 à Medellin, en Colombie. Ceux-ci dénoncèrent « le colonialisme que pratiquent à l’intérieur de notre continent des groupes privilégiés qui maintiennent leurs richesses au prix de la misère de leurs compatriotes ». Une des convictions centrales de la théologie de la libération est qu’il existe, à côté du péché personnel, un péché collectif et structurel, c’est-à-dire une structuration de la société et de l’économie qui cause la souffrance, la misère et la mort d’innombrables frères et sœurs humains.
Voici ce qu’écrit l’archevêque de Recife Dom Helder Camara sur le lien entre l’Évangile et la dénonciation de l’injustice : « Et parce que cette faim, cette misère sont des conséquences des injustices et des structures d’injustice, le Seigneur exige de nous la dénonciation des injustices. Cela fait partie de l’annonce de la Parole. La dénonciation de l’injustice est un chapitre absolument nécessaire de l’annonce de l’Évangile. »
Le Vatican sous Jean-Paul II a approuvé l’affirmation que « l’injustice structurelle ne peut être abolie que par un changement de structures ». Certes, le pape a mis en garde contre les excès de la théologie de la libération, quand elle semblait oublier la dimension spirituelle du combat social et quand elle paraissait flirter avec le communisme ou prôner la violence armée. Mais on ignore souvent que Jean-Paul II eut des paroles extrêmement sévères à l’égard du capitalisme. Quant à Helder Camara, il s’insurgeait contre les chrétiens conservateurs qui lui reprochaient son engagement : « Quand je donne à manger aux pauvres, on m’appelle un saint. Quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on m’appelle communiste », disait-il.
La « transformation structurelle de la société » dont il est question signifie, par exemple, le combat politique pour la redistribution des terres aux paysans et l’expropriation des grands propriétaires terriens, la lutte syndicale pour l’instauration des lois régulant le travail et instaurant un minimum de sécurité et de dignité, l’engagement pour l’abolition de la dictature et pour l’instauration des libertés et de la démocratie.
La mise en question des Églises et de leur théologie classique
Les adeptes de la théologie de la libération sont des protestataires au sein même de leurs Églises respectives. Ils disent que les pauvres mettent en question la mission et l’identité de l’Église. Ils dénoncent le fait que les paroisses classiques reflètent des valeurs bourgeoises. Les pauvres ne s’y sentent pas à l’aise : ce n’est pas leur Église. Celle-ci reste souvent silencieuse à l’égard de l’injustice. Ce silence équivaut à un acquiescement et donc à une collaboration avec un système d’oppression qui viole les promesses de l’Évangile. Au mieux, l’Église agit par des œuvres caritatives en faveur des pauvres, mais ce n’est pas suffisant. Elle doit devenir « l’Église des pauvres », dans les pays où ceux-ci constituent la majorité. L’Église doit donc se convertir, sortir de sa neutralité et d’une religiosité intimiste et désincarnée. Ils condamnent la religiosité « privatisante », celle qui réduit le salut à une affaire individuelle et sans rapport avec le contexte social. L’Église rencontre le Christ dans les pauvres. Le chapitre 25 de l’Évangile de Mathieu est explicite : ce que nous faisons aux plus pauvres, c’est à Lui que nous le faisons.
Cette conversion de l’Église par les pauvres requiert aussi, affirme la théologie de la libération, une mutation radicale de la théologie. Celle-ci ne peut plus se nourrir de spéculations sur Dieu, inspirées notamment par la philosophie grecque, ni se réduire, comme dans les pays riches, à un discours de type universitaire. La théologie doit être l’expression d’un vécu spirituel, celui d’un peuple qui souffre, qui prie et qui lutte parce qu’il a confiance en Christ mort et ressuscité. Olivier Clément observe que, du point de vue orthodoxe, il s’agit d’une authentique théologie, car elle exprime une expérience de foi et de prière. Elle n’est pas le fruit de théologiens en chambre.
Les théologiens de la libération veulent que la théologie soit celle d’un peuple face à son contexte social immédiat et concret. La théologie ne saurait être anhistorique, disent-ils, déconnectée du temps présent et des conditions concrètes dans lesquelles vivent les gens, et en particulier les plus pauvres.. Il faut donc « contextualiser » la théologie et inviter les pauvres à se réapproprier la Bible comme une parole de libération et d’espérance qui leur est spécifiquement adressée. Ils découvrent alors que la Bible les aide à comprendre leur rôle dans la société et leur donne un regard critique. Le christianisme a été trop souvent un obstacle à leur libération, voire la cause de leur misère (par exemple la violence spoliatrice de conquistadors brandissant la croix, les marchands d’esclave et les grands propriétaires prêchant la soumission à leur Dieu).
Voici ce qu’en dit Dom Helder Camara : « Le paysan, le fils et le petit-fils de paysan de nos régions sont comme des morts-vivants […] Ils ont appris auprès de leurs parents analphabètes et dans les chapelles de leurs maîtres et seigneurs, qu’il faut être patient comme le fils de Dieu, si injustement traité et mort sur la croix pour nous sauver. Ils en déduisent que telle doit bien être leur vie. Mis à l’école d’un christianisme fataliste, ils conçoivent que les uns naissent riches et les autres pauvres, puisque telle est la volonté de Dieu. » Dès lors, l’évêque brésilien n’a de cesse que ces plus pauvres parmi les pauvres prennent conscience de leur dignité humaine et de leurs droits, car aucune croissance vraiment humaine n’est possible quand on n’a même pas « conscience de vivre à un niveau infrahumain et lorsqu’on ne sait pas qu’on a droit à une vie meilleure, digne vraiment de l’homme. »
L’Église doit devenir ce qu’après les prophètes, le Christ a voulu qu’elle soit : une force libératrice. Faute de cela, les pauvres chercheront hors de la Bible et de l’Église l’énergie qui leur est nécessaire pour résister et pour changer leur réalité.
L’Exode, archétype de la libération
La théologie de la libération s’inspire essentiellement du livre de l’Exode : « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. J’ai prêté l’oreille à la clameur que lui arrachent ses maîtres. Je connais ses angoisses. Je suis résolu de le délivrer de la main des Égyptiens et à le faire monter de ce pays vers une contrée plantureuse et vaste » (Ex 3, 7-8). Il s’agit donc de se libérer de l’oppression (dictature, capitalisme sauvage, etc.) et de cheminer, avec l’aide de Dieu, vers la liberté, la fraternité, la justice sociale, voire des formes de socialisme radical. Il s’agit de s’arracher des mains du « pharaon » actuel, le capitalisme, de traverser la « mer rouge » par un rude combat social pour arriver à la « terre promise » d’une société plus juste et plus conforme à l’Évangile. La pâque du peuple hébreu préfigure la résurrection pascale. Dans « résurrection » se trouve la racine du terme « insurrection ».
Aujourd’hui, l’écroulement du monde socialiste « réellement existant », la déroute des révolutions populaires, la mondialisation et ses inégalités croissantes, l’hégémonie du néo-libéralisme bouleversent l’horizon de la théologie de la libération. Au lieu de penser un projet social unique plus ou moins proche des expériences socialistes révolutionnaires des pays du Sud (par exemple, Cuba, la Tanzanie…), la théologie de la libération s’est mise, au cours de la dernière décennie, à penser la pluralité des projets collectifs. Elle s’est intéressée à l’altermondialisme et au Forum Social Mondial qui s’est réuni plusieurs fois à Porto Alegre (Brésil). Auparavant, il s’agissait du pauvre en général. Désormais, il est question du Noir, de l’Amérindien, de la femme en tant qu’opprimés.
Les théologiens de la libération découvrent aussi l’importance de l’écologie. Ils sortent ainsi du carcan intellectuel trop matérialiste et trop rationaliste d’un certain marxisme, tout en conservant sa critique sociale radicale et son idéal de fraternité humaine. Ils acquièrent, surtout avec Leonardo Boff nourri de spiritualité franciscaine, et à la requête des communautés de base notamment amérindiennes, une sensibilité cosmique, que les orthodoxes qualifieraient (avec le philosophe religieux russe Serge Boulgakov ) de « pan-enthéiste ». Ils s’ouvrent à d’autres cultures, moins marquées par la philosophie des Lumières et son projet de maîtrise et de progrès effréné. La théologie de la libération acquiert des caractères plus « féminins », tout en conservant son ardeur révolutionnaire. Les communautés chrétiennes de base restent le lieu privilégié de cette théologie. De nombreux membres les ont quittées cependant, pour rejoindre des mouvements pentecôtistes plus conservateurs sur le plan social, mais plus chaleureux dans l’expression de la foi. Dès lors, des « alléluias » de louange sont venus enrichir le répertoire de ces communautés de base jadis habituées surtout à des chants de luttes et d’espérance terrestre.
Plus récemment, des théologiens latino-américains tels que Enrique Dussel ou Franz Hinckelamert ont élargi le propos. Il ne s’agit pas seulement de refuser le système capitaliste et matérialiste et d’opter pour une société plus juste. Il s’agit avant tout de refuser la mort et les forces de mort. Ces dernières sont multiples, qu’il s’agisse du surarmement des États ou de la violence faite aux pauvres, de l’obsession du profit et du pouvoir, de l’hyper-compétitivité élevée en diktat, de la destruction de l’environnement. Ces théologiens développent avec les communautés de base une prière et une pensée qui célèbre la vie et les forces de vie. Dieu veut la vie et est l’ennemi de tout ce qui apporte la mort. Le capitalisme mondialisé est une fausse « religion », sans transcendance mais d’essence sacrificielle. La théologie de la libération démasque la supercherie de la mondialisation néo-libérale qui conduit à bénir les riches et à punir les pauvres. Elle oppose aux forces de mort, mobilisées par Mammon, la force de Vie du Dieu de la Bible qui a « entendu les cris de son peuple ». Ce Dieu de vie invite à se mettre debout. Il donne force et sens à l’être pascal qui continue, malgré les apparences, à croire dans la vie.
Une spiritualité de la libération
« Qu’as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier du sol vers moi » (Gn 4, 10). Cette question est reprise maintes fois par les théologiens de la libération, car elle appelle le chrétien à la conversion. Elle dit que la pauvreté de ce monde, loin d’être le produit du hasard, est la conséquence des actions injustes et pécheresses de l’être humain. Jon Sobrino dit aux nantis de « reconnaître cette vérité » et à « ne pas maintenir la vérité captive dans l’injustice » (Rm 1, 18). Les pauvres, « rebuts de l’humanité », sont crucifiés, dit ce théologien d’Amérique centrale au moment où le dictateur au pouvoir au Guatemala, appartenant à une Église réformée, commettait de véritables massacres à l’égard des habitants (principalement indiens) de son pays. De tels évènements, hélas si fréquents, montrent qu’il y a du péché dans la réalité de ce monde. Certes, le péché n’est pas le tout de cette réalité. Mais tant qu’on ne l’a pas perçu comme un péché flagrant, un « péché structurel » (c’est-à-dire inscrit dans les structures économiques et sociales), on n’est pas encore arrivé à découvrir la mise en question radicale qui nous est adressée.
Le monde doit changer. Le statu quo est scandaleux. Les pauvres ne sont pas qu’un « problème », ajoute Jon Sobrino. Les pauvres sont, pour le chrétien, « le lieu historique de Dieu ». C’est en eux qu’on rencontre le Christ. Ils sont les aimés de Dieu. Comme le Christ, ils portent le péché du monde. Cette dernière pensée a inspiré au prêtre franco-brésilien Fredy Kunz une pensée à partir des quatre chants du Deutéro-Isaïe (Is 55ss). Elle allie théologie et mystique. Il l’a appelée la « Mystique du Serviteur souffrant ». Frédy Kunz disait au sujet de son action et de la fraternité qu’il a créée : « La théologie de la libération, c’est la tête. L’action non violente gandhienne, ce sont les pieds. La mystique du Serviteur souffrant, c’est le cœur. »
Gustavo Gutierez, le fondateur péruvien de la théologie de la libération, insiste sur le fait que notre action en solidarité avec les pauvres, ne relève pas d’une simple « dimension sociale de la foi ». Il ne s’agit pas de quelque vertu morale. Il s’agit d’un face-à-face, d’une rencontre avec Dieu au cœur d’une action portée par l’amour.
Les théologiens de la libération insistent sur le fait que la solidarité active relève d’un amour authentique qui les a amenés à partager, au moins partiellement, les conditions de vie des exclus. Ce don va de pair avec de l’affection et de la tendresse. Sans cette amitié et cette proximité, au sein des favelas , des taudis et des campagnes où règnent la faim et la misère, il peut certes y avoir des actions bien intentionnées, mais ne restent-elles pas froides et impersonnelles ? La théologie de la libération met ainsi en question à la fois les « bonnes œuvres » caritatives, les « projets de développement » parachutés d’en dehors des communautés ainsi que l’action volontariste mais parfois impitoyable de certains partis révolutionnaires se considérant comme « l’avant-garde » du peuple.
Cette rencontre de Dieu dans les pauvres implique une ascèse, un travail sur soi. L’homme se décentre et trouve sa propre réalisation en se donnant à autrui. Chemin faisant, le chrétien aura à se demander s’il veut vraiment supprimer la douleur d’autrui et s’il cherche réellement sa libération et non pas avant tout – même subtilement – le sens de sa propre vie (même si, en fait, on trouve ce sens dans cette pratique). Le pauvre est celui qui, d’une façon très concrète, place l’être humain devant l’alternative de se choisir lui-même ou de choisir l’autre, d’accepter ou non des expressions évangéliques aussi simples qu’ « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». Tout ce chemin ascétique n’est pas une chose aisée. Le pauvre est tellement autre qu’il exige le décentrement de soi.
En outre, l’engagement pour la justice, peut coûter cher en termes de réputation et de statut social. Nombreux sont ceux qui ont été l’objet de calomnies comme Dom Helder Camara traité « d’évêque rouge », voire d’attentats criminels, tel que Mgr Oscar Romero du Salvador, fauché à la mitraillette alors qu’il célébrait la messe à l’autel. La mort et le martyre sont des réalités qu’un amour libérateur prend en compte : des milliers de laïcs, de religieuses et de prêtres ont versé leurs sang pour leurs frères et sœurs appauvris. Ils ont affronté courageusement les pouvoirs en place. Ils ont été les victimes des « escadrons de la mort » qui assassinent au service des riches et de certaines multinationales, quand celles-ci ne reculent devant rien pour protéger les privilèges exorbitants dont elles jouissent dans certains pays du Sud.
L’action non violente, violence des pacifiques
S’il y eut des chrétiens engagés qui, tel le prêtre colombien Camillo Torez, n’hésitèrent pas à rejoindre un mouvement armé de libération, d’autres se prononcèrent pour l’action non violente. Dom Helder estime qu’il faut opposer la force de la non-violence active aux trois violences dont souffrent les pauvres : la violence des oppresseurs dont la richesse se nourrit de la misère de leurs concitoyens ; la violence du monde riche contre les pays du Sud à travers des échanges commerciaux injustes et l’exploitation des ressources naturelles ; la violence perpétrée pour les États au nom de la défense de l’ordre établi, qui conduit à qualifier de subversion toute tentative de changement de cet ordre.
A l’exemple de Martin Luther King et du mahatma Gandhi, il faut opposer à ces trois types de violence celle que le frère Roger Schütz de Taizé appelait « la violence des pacifiques ». Elle se situe dans la perspective évangélique du pardon. Elle vise, en définitive, la réconciliation et la paix, mais fondées sur la justice. L’action non violente implique, par exemple, le refus d’obéir à la loi, le non-paiement de l’impôt, la grève générale, la dénonciation publique des abus – au risque de sa vie – et toujours le dialogue inlassable avec les agents plus ou moins conscients du pouvoir injuste.
Cette non-violence accepte qu’il puisse y avoir des victimes dans ses rangs, mais elle se refuse à en faire dans ceux de l’adversaire. « Il n’y a pas de victoire contre l’oppression et les structures d’injustice sans sacrifice. Les sacrifices acceptés par la non-violence préparent mieux l’avenir et la réconciliation que les sacrifices imposés par la violence ». Mais la non-violence n’est jamais lâcheté ni immobilisme. « Une non-violence qui ne se préoccuperait pas d’être vraiment une action capable de faire l’histoire serait encore du « passivisme » déguisé sous de grands principes et de beaux sentiments », précise Dom Helder.
Quelle espérance dans le monde actuel ?
Voyant comment va le monde aujourd’hui, pourquoi ne pas se résigner ? Comment ne pas verser dans le désespoir et le cynisme ?
Ce sont les pauvres, disent les théologiens engagés, qui maintiennent la véritable espérance : « L’espoir des pauvres ne périt jamais », affirme le psalmiste (Ps 9, 19). Les pauvres pour lesquels survivre est une tâche première et mourir le destin le plus proche, ont et maintiennent une espérance surprenante. Leur espoir et leur courage sont certes confortés par des victoires partielles et des solidarités concrètes faites de joie fraternelle et d’entraide. Mais les racines de leur espérance se nourrissent aussi d’une autre sève : un acte premier de confiance en un Dieu Père. Ils pressentent et nous enseignent que la justice et la bonté existent au fond de la réalité et que, malgré tout, le bien est plus originel et plus puissant que le mal. Dans les communautés chrétiennes de base, des gens quelquefois se lèvent et disent qu’ils acceptent que le vrai salut passe aussi par leur propre crucifixion. Certains expriment parfois en paroles parfaitement explicites que c’est le Serviteur souffrant qui donne la véritable espérance. Rien de tout cela ne leur enlève leur dynamisme pour travailler activement à la libération. Ils intègrent le scandale de la croix dans leur espérance, car ils savent – mieux que les nantis – que la croix est enceinte de la résurrection.
Les théologiens qui rapportent ces dires, ajoutent humblement qu’en définitive, c’est à une « théologie négative de l’espérance » qu’ils aboutissent : l’apophatisme (le non-dire) devant le mystère de la souffrance et devant l’espérance. Une chose leur paraît certaine : en dernière analyse, l’espérance vit de l’amour. Celui qui aime les pauvres de manière radicale et désintéressée fait quelque chose d’absolument bon, qui sera accueilli pour toujours dans l’histoire du Salut. Celui qui agit par amour et dans l’espérance est en train de dire que le mystère ultime de la réalité est un mystère de bonté et de salut.
Jean-Thierry Verhelst
Texte paru dans la revue Le Chemin, 73, hiver 2006.

12:55 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans THÉOLOGIE CONTEXTUELLE. | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, foi, spiritualite-de-la-liberation, spiritualite, action-sociale-chretienne |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|
03/12/2006
Sida et spiritualité...
À la mémoire de Jean-Gilles Godin qui, blessé par l'Ange Noir du Sida, s'est battu contre lui pendant une longue nuit. Puisse la blessure être devenue, pour lui, bénédiction.
*
Il n'est pas facile trouver ce qu'on pourrait appeler «le ton juste» pour parler du SIDA, de l'expérience de ceux et celles qui vivent avec le SIDA, mais aussi bien de ce monde dans lequel nous sommes pris pour vivre avec cette redoutable maladie sans doute un bon moment encore. On se sent en effet comme écartelé entre l'envie de hurler - de colère, de révolte ou de défi -, celle de pleurer - de tristesse, d'impuissance ou de rage -, mais aussi, simplement, de se taire - par pudeur, par respect, ou juste par conscience de la prodigieuse prétention, de la vertigineuse futilité des mots... Pourtant, dans ce vaste combat qu'est la lutte pour la vie et pour l'espoir, toutes les ressources, en fin de compte, doivent être mises à contribution: la science, l'argent, le temps, la tendresse - et sans doute aussi, dès lors, ces choses infiniment fragiles que sont les mots.
Sida et spiritualité...
En voyant ces deux mots associés, il nous vient fort probablement, en vrac et pêle même, toute sorte d'images, toute sorte d'autres mots: Dieu, foi, doute, valeurs, morale, amour, culpabilité, sagesse, souffrance, angoisse, compassion, mort, vie, espoir - et bien d'autres encore...
Ce qu'on appelle - sans toujours très bien savoir ce qu'on veut dire par là - «spiritualité», «sagesse de vie», «expérience intérieure», «religieuse» ou «mystique» , semble en tout cas avoir au moins ceci de commun avec le SIDA que cela concerne ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre la vieille expression de la Bible, le «combat des humains avec l'Ange», l'expérience - la bataille - des hommes et des femmes «autour» des limites de la condition humaine et de ce qui la déborde. Si la réalité du SIDA nous interpelle aussi directement, aussi brutalement aujourd'hui au plan de la «spiritualité», c'est bien possiblement parce que, dans une large mesure, nous vivons dans un monde où nous avons souvent la tentation de croire qu'il n'y a plus de limites, que celles-ci ont été abolies:
- plus de limites aux horizons que la science explore - que ce soit dans l'infiniment grand, l'infiniment petit ou l'infiniment complexe;
- pas de limites à la puissance que la technique met en oeuvre et au progrès qu'elle permet d'entrevoir;
- pas de limites à la créativité, à l'inventivité humaine;
- pas de limites, non plus, au désir que tous et toutes nous portons en nous et aux possibilités de l'accomplir sans contrainte ni retenue;
- pas de limites à la vie elle-même, à la possibilité de la fabriquer presque, déjà, d'en améliorer la qualité, de la prolonger de plus en plus, voire - pourquoi pas - à l'inifini...
Ou bien, alors - et ce serait au fond une autre manière de dire à peu près la même chose -, nous avons le sentiment de vivre dans un monde que nous contrôlons . De contrôler le monde dans lequel nous vivons:
- nous partageons l'ambition d'une société qui continue - «Phase II» de la Baie James - de harnacher les rivières pour produire de l'électricité;
- nous avons encore au moins l'«illusion démocratique» de pouvoir élire ceux qui nous gouvernent;
- la terre que nous habitons a été sillonnée par d'innombrables réseaux de communications - qui faisaient dire à MacLuhan que la planète était devenue un «village global» où l'on sait tout ce qui se passe, presque instantanément;
- nous vivons dans des maisons chauffées en hiver et climatisées en été, dans un monde où tout est prévu, géré, «sous contrôle». De notre naissance à notre mort - celle-ci comprise! -, nous sommes «pris en charge» par les institutions et les spécialistes de toutes sortes, des pédiatres aux thanatologues, en passant par les dentistes, les psycho-thérapeutes, les sexologues, les agents d'assurance et les réparateurs Maytag...
Or, si le SIDA nous interpelle aussi directement au plan de ce qu'on peut appeler une «interrogation spirituelle», c'est vraisemblablement parce qu'il vient brutalement nous rappeler la présence de brutales limites au coeur de notre monde, de nos vies, de nos désirs. C'est parce qu'il vient brutalement nous rappeler les limites de notre contrôle .
Certains se souviendront sûrement d'avoir lu, dans une livraison du Devoir de novembre dernier, la fort intéressante réflexion d'un professeur de philosophie, Pierre Bertrand, à partir du tremblement de terre qui venait de secouer le Québec quelques jours auparavant. «Il faut, écrivait Bertrand, que les puissances du dehors absolu fassent inopinément intrusion dans nos habitudes de vie pour que nous nous mettions à mettre en doute la belle assurance qui est la nôtre.» Et même là, ce n'est pas si évident que ça: il nous faut en effet toujours beaucoup de temps pour enregistrer ce qu'il y a d'imprévu , d'inédit dans un évènement comme celui-là. Nous le savons, nous l'avons tous plus ou moins vécu ainsi: nous ramenons tout d'abord cet inédit à du familier, à du connu: c'était les enfants qui faisaient du bruit dans la chambre ou qui donnaient des coups de pied sous la table, les chats qui se couraient après dans le couloir, la laveuse qui vibrait plus fort que d'habitude, un autobus ou un gros camion qui passait dans la rue...
«En fait, poursuivait le professeur de philosophie, la prise de conscience du tremblement de terre comme tel n'eut lieu qu'après coup, comme dernière hypothèse explicative, après que toutes les autres furent essayées et épuisées. Tellement l'inconnu doit insister avant que nous acceptions de lui ouvrir enfin la porte, et combien nous sommes prompts à la lui refermer sur le nez à la première occasion» - à travers nos bavardages, par exemple, ou ceux des média, qui finissent rapidement par banaliser complètement l'évènement. Pourtant, de conclure, le philosophe: «Il ne faut pas s'empresser d'oublier trop rapidement ces moments où le dehors surgit à l'intérieur de nos vies. Il y a là quelque chose qui gronde en dessous de nos certitudes».
L'image est forte, mais elle donne à penser: le SIDA est un tremblement de terre dans nos vies. C'est un ébranlement des certitudes sur lesquelles nous vivions depuis un moment déjà - aussi bien celle d'une sexualité sans «risques» et sans «conséquences» que celle de la toute puissance de la science à nous délivrer de ce qui nous empoisonne encore l'existence. Et même là, il nous faut une très forte secousse sur l'échelle de Richter de nos certitudes pour vraiment ébranler celles-ci: combien parmi nous, par exemple, échappent complètement à la tentation, quand ils pensent au SIDA, de penser d'abord au moment où cette «toute puissance» de la science et du progrès médical aura enfin trouvé un remède, un vaccin, un antidote - une «solution»?
Une telle attitude est bien sûr tout à fait compréhensible et légitime. Mais elle amène à suggérer que, par comparaison, la spiritualité , ce serait probablement, plutôt, la manière d'habiter humainement le présent, de donner un sens au présent dans lequel nous sommes pris pour vivre - d'une manière ou d'une autre - avec le SIDA, comme avec nos vieilles certitudes ébranlées par le tremblement de terre.
Dans un monde comme le nôtre, par ailleurs, parler de spiritualité, c'est parler de quelque chose que plusieurs d'entre nous avions plus ou moins rangé depuis un bon moment dans la naphtaline - quand nous ne l'avions pas simplement «mis au chemin», avec les vieilleries inutiles et encombrantes.
Parler de spiritualité dans un monde comme le nôtre, c'est aussi, nécessairement, parler au pluriel . Et le fait est que l'apparition du SIDA dans le paysage de nos vies a fait émerger toutes sortes de recherches, de questionnements spirituels, souvent très différents les uns des autres - allant par exemple de la redécouverte d'une expérience religieuse très traditionnelle (au sens pas du tout péjoratif du terme) à l'exploration de pistes nouvelles, ou en tout cas moins familières à nos traditions occidentales - qu'il s'agisse par exemple de diverses «techniques de soi», de diverses formes d'auto-thérapie ou d'actualisation des pouvoirs souvent insoupçonnés de guérison que nous portons en nous.
Sauf à se situer dans une perspective très étroitement confessionnelle, il est difficile de soutenir que des spiritualités seraient plus «vraies» que d'autres. On admettra plus volontiers qu'il y a plutôt des façons différentes d'habiter humainement un présent, de «négocier» avec des limites. En revanche - et il est important de ne pas l'oublier -, les voies que peut emprunter cette recherche de spiritualité sont fort différentes les unes des autres, et elles peuvent même, à l'occasion, paraître contradictoires ou incompatibles entre elles. On peut ainsi penser - et l'exemple est loin d'être purement théorique - à la confrontation qu'il peut y avoir entre des «voies spirituelles» davantage centrées sur un «apprivoisement» de la souffrance et de la mort, disons, et d'autres qui, au nom d'un combat acharné «pour la vie», pourraient être tentées de considérer les premières comme une sorte d'«abdication», voire une «trahison défaitiste». En ce sens là, on peut penser qu'il nous faut, tous, et en tout état de cause, faire de la place dans nos démarches pour une «spiritualité de la tolérance et de la cohabitation».
Mais on peut également songer à des courants spirituels issus de traditions très différentes de la nôtre, qui ont cependant influencé plusieurs de nos contemporains depuis un certains nombre d'années: spiritualités d'origine orientale notamment, pour lesquelles notre petit «moi» n'est au fond qu'une illusion bien fragile et bien éphémère. Pour bien des courants spirituels ainsi marqués par l'Orient, nous ne sommes que des lieux passagers où la vie se cristallise un moment, où la vie parle un instant avec notre précaire petit «JE» - avant que celui-ci ne retourne, comme une goutte d'eau, à l'insondable «océan de l'être» d'où il provient. On comprend aisément que, dans un paysage spirituel de ce type, le drame qui affecte l'histoire particulière de chacun de nos petits «moi» n'a pas la même résonnance qu'il a sans doute pour la majorité d'entre nous. À la limite, la mort elle-même y est perçue davantage comme une libération que comme une tragédie...
Pour le meilleur et pour le pire, l'Occident auquel nous appartenons nous a appris à accorder une importance beaucoup plus grande - voire absolue - aux petits «moi» que nous sommes et qui ont, pour cette raison, beaucoup de mal à accepter la limite de leur minuscule royauté - que ce soit celle de la frustration du désir, de l'échec, de la maladie, et, bien sûr, la plus scandaleuse de toutes: celle de la mort, surtout lorsque cette limite surgit (comme un tremblement de terre) au moment où on s'y attend le moins, comme c'est le cas des maladies incurables qui frappent les enfants, par exemple, et comme c'est le cas du SIDA, qui semble s'en prendre avec une cruauté particulière à des hommes et à des femmes au plus vigoureux de leur vie, au creux de leur plus vivante passion.
Dans cette tradition occidentale qui est la nôtre (que l'on soit beaucoup, un peu, très mal ou pas du tout croyant) viennent à l'esprit un certain nombre de «figures», susceptibles d'inspirer notre recherche d'une spiritualité au temps du SIDA, et qui ont entre autres choses l'intérêt de nous montrer - si l'on en doutait vraiment - que les questions fondamentales auxquelles le SIDA nous confronte aujourd'hui sont loin d'être complètement nouvelles. On en retiendra deux, parmi bien d'autres possibles.
La première de ces figures est connue - quoique souvent assez mal, et de manière plus ou moins caricaturale. C'est celle de Job, héros fictif d'un récit vieux de 2500 ans, qui pose au fond une seule question - laquelle n'a jamais, depuis lors, cessé de hanter la conscience occidentale (jusqu'à Camus par exemple, en notre temps): pourquoi les humains souffrent-ils - et, surtout, pourquoi la souffrance des innocents ?
Dans le récit biblique, Job est présenté comme un «honnête homme», un «juste», qui vivait à l'aise, heureux et sans histoire. À partir de là, l'auteur imagine un scénario où Dieu permet à Satan (qui est un peu, si l'on ose dire, son «exécuteur des sales boulots») de mettre Job à l'épreuve, pour voir si celui-ci va demeurer aussi «fidèle» dans ses malheurs. Job perd ses biens, il perd ses enfants -- un peu comme Martin Grey dans son récit autobiographique. Ça l'affecte, bien entendu, mais ça ne l'ébranle pas dans ses assises profondes: Job accepte que Dieu reprenne ce qu'il lui avait donné. Même atteint dans son propre corps par une lèpre répugnante, Job refuse de suivre sa femme qui lui conseille de maudire Dieu à cause de la manière dont celui-ci l'a injustement traité.
C'est alors que trois de ses amis viennent pour le réconforter. Ceux-ci arrivent avec les «gros sabots» de leur bonne volonté et de leur bonne conscience: ils ne sont évidemment pas eux-mêmes aux prises avec le drame de Job! Et, au fond, les trois finissent par défendre les croyances traditionnelles de leur époque en essayant de convaincre Job que ce qui lui arrive est certainement de sa faute, qu'il s'agit sûrement d'une punition divine - puisque Dieu est juste... Mais Job n'est pas d'accord et il proteste de son innocence, en même temps qu'il se heurte au mystère de ce Dieu que lui aussi, pourtant, il continue de croire juste. Job se débat avec sa question, oscillant entre la révolte et la résignation, entre des crises de souffrance et des périodes de rémission.
Arrive encore un autre personnage qui, du haut de sa certitude, se met à faire la leçon à tout le monde, en prétendant, lui, carrément, justifier la conduite de Dieu. Mais, là, c'est Dieu lui-même qui en a pour ainsi dire assez, et qui intervient pour dire aux amis de Job: «bon, ça suffit, vous parlez à travers votre chapeau...» Pourtant, Dieu ne répond pas vraiment lui non plus à la question de Job - sinon en manifestant qu'il est plutôt d'accord avec celui-ci, que ce qui arrive à Job n'a, de fait, rien à voir avec une quelconque «punition». Mais Dieu n'essaie pas davantage de se défendre lui-même ou de s'expliquer.
Ce qui ressort de ce récit c'est que, au fond, il n'y a pas de réponse - au moins, en tout cas, au plan des explications rationnelles. Dieu se contente de demander à Job - et ce sont parmi les plus belles pages de la Bible qu'il faut hélas se résoudre à résumer ici bien rapidement: «Job, étais-tu là quand j'ai fait le monde, quand j'ai installé le ciel et fixé les étoiles? Où étais-tu, Job, quand j'ai organisé la terre et semé la vie dans les océans, quand j'ai réglé le cours des astres et celui des saisons?...»
Et Job prend conscience de la limite à laquelle il se heurte, malgré sa sagesse et son intelligence: celle d'un univers qui le dépasse, d'un monde où les choses fonctionnent en général plutôt bien - mais où il leur arrive aussi à l'occasion de se dérégler. Un monde où il se produit aussi, de temps en temps, des tremblements de terre. Quelque chose pourtant, devant cet ordre grandiose de la Création qui se déploie devant lui, réduit sa révolte au silence d'une confiance que la raison seule ne saurait expliquer.
Nous ne sommes pas si loin ici, quand on y pense, d'une spiritualité d'inspiration très différente: celle de la Chine ancienne - que l'on retouve par exemple dans le taoïsme et le Yi-king ; une spiritualité fondée essentiellement sur la conviction que le monde est en perpétuelle transformation - comme le courbe d'un biorythme - et que les humains ont le choix: ou bien de se casser les dents et de se rendre malheureux à vouloir qu'il en soit autrement, ou bien de se mettre en harmonie avec ce mouvement du monde, et de faire la paix avec ce mystère d'un univers dont le sens, ultimement, échappe à notre entendement.
Étrangement, nous ne sommes pas très loin non plus d'une autre «spiritualité» très différente : celle de la «responsabilité» et du «projet», dans la philosophie - athée - de Jean-Paul Sartre pour qui, dans ce monde en lui-même absurde , le sens ne peut être donné que par les humains eux-mêmes. (Comme le disait Sartre, par exemple, à propos de Jean Genet, devenu écrivain et poète même si toute son éducation avait d'abord fait de lui un criminel et un voleur: «l'important n'est pas ce que l'on a fait de nous mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que l'on a fait de nous».)
La deuxième figure que l'on évoquera rapidement ici est connue elle aussi, et même beaucoup plus sans doute - quoique souvent de manière également un peu simpliste. C'est celle de François d'Assise, que l'on se représente peut-être un peu trop à la manière naïve des images pieuses - ou à celle de Zeffirelli! - avec des grands yeux candides en train de parler aux petits oiseaux... On aura plutôt ici à l'esprit un très beau texte de François d'Assise, le Cantique des créatures - qui est une grande prière de louange, de reconnaissance pour la beauté du monde, dans laquelle saint Françoi se présente en quelque sorte comme le frère de toutes les créatures:
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère, monseigneur le Soleil,
et pour notre soeur la Lune;
pour notre frère le Feu et pour notre soeur l'Eau;
loué sois-tu pour la Terre, notre soeur et notre mère,
et pour mon frère, le Corps;
mais, aussi, loué sois-tu pour notre soeur la Mort
- à qui nul vivant ne peut échapper...
*
Nul ne peut dire, bien sûr, si François d'Assise, aujourd'hui, pousserait l'audace jusqu'à parler, dans sa louange, de «son frère», le SIDA...
L'auteur de ces pages n'aurait sans doute pas eu lui-même celle de le proposer s'il ne l'avait entendu presque dans ces termes l'été dernier, dans la bouche d'un jeune prêtre vivant depuis un moment avec le SIDA. Et celui-ci d'exprimer comment, après un temps de révolte et de colère (que personne n'aura de mal à comprendre), il avait fini par apprivoiser cette proximité de la mort au travail dans son corps - comme on le dit pour un douloureux travail d'enfantement; et que, à travers cette sorte d'étrange amitié, de mystérieuse et presque fraternelle complicité avec le SIDA, c'est avec la VIE qu'il était en train de régler ses comptes, de se réconcilier.
Il y a sans nul doute bien d'autres voies possibles en vue d'une spiritualité «au temps de SIDA», y compris dans cette tradition de l'Occident judéo-chrétien qui nous marque souvent plus que nous ne pensons, même à notre insu:
celle des croyants qui vivent la souffrance de leur corps comme communion à celle du Christ - un juste , lui aussi injustement mis à mort;
celle pour laquelle il est illusoire de prétendre rencontrer Dieu ailleurs qu'à travers les hommes et les femmes qui, justement parce qu'ils ont mal dans leur corps et dans leur âme, sont, parmi nous, les frères et les soeurs privilégiés de Jésus-Christ («Ce que vous aurez fait au plus fragile d'entre ces êtres douloureux qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait» . Évangile de saint Mathieu , 25);
ou celle encore - plus guerroyante - des preux chevaliers qui se battent héroïquement jusqu'à la mort - avec la conviction que ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot...
Ces pages ont voulu autant que possible éviter «le coup» des amis de Job - qui prétendaient avoir LA réponse... D'une manière infiniment plus modeste, elles ont plutôt cherché à exprimer le souhait que nous nous laissions ébranler par ce «tremblement de terre» qui surgit dans nos vies sans crier gare. Mais aussi bien, comme le suggérait le beau texte de Jean-Gilles Godin paru dans le Devoir du 1er décembre 1988, que nous ayons le courage de croire que l'espoir ne peut pas être «faux» si on le place là où est le seul véritable lieu de la «spiritualité»: celui du coeur.
12:37 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans THÉOLOGIE CONTEXTUELLE. | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, foi, spiritualite-de-la-liberation, action-sociale-chretienne, spiritualite, social, poesie |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg | |
Digg | | ![]() Facebook | |
Facebook | |  |
|




















